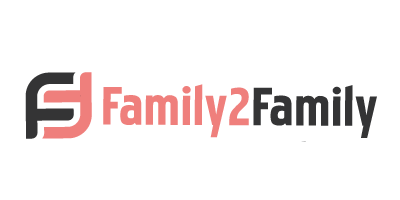En France, la loi interdit depuis 2019 toute forme de violence physique ou psychologique à l’encontre des enfants, y compris la gifle. Pourtant, selon une enquête de l’Union nationale des associations familiales, plus d’un parent sur deux admet avoir déjà eu recours à ce geste.
Comprendre l’impact d’une gifle sur le développement de l’enfant
La gifle n’a rien d’un geste banal. On la range parfois dans la catégorie des violences éducatives ordinaires, comme si elle ne laissait pas de traces. Pourtant, chaque coup, même isolé, s’imprime dans le parcours de l’enfant. Les neurosciences le montrent : son cerveau, encore formé pour apprendre et se développer, reçoit un choc quand ses repères vacillent sous la violence. Le stress monte en flèche, le cortisol envahit l’organisme ; l’enfant se retrouve privé de ses armes pour comprendre ses émotions et grandir en confiance.
Une gifle ne disparaît jamais complètement. Elle s’insinue dans la mémoire, déstabilise l’estime de soi, fissure la relation avec celui ou celle qui la donne. Les travaux de l’Inserm et de l’OMS sont limpides : la répétition de tels gestes démultiplie les risques d’anxiété, de troubles dépressifs et de difficultés à créer des liens solides.
Plus concrètement, la recherche a identifié plusieurs dangers majeurs associés à ces pratiques :
- Augmentation du risque de troubles psychologiques : l’enfant peut s’isoler, devenir anxieux, ou parfois reproduire la violence.
- Relations parents-enfants fragilisées, parfois durement et pour longtemps.
- Normalisation de la violence physique comme manière de régler les désaccords.
Ces gestes ne touchent pas seulement l’esprit. Le corps encaisse aussi, sur la durée : troubles du sommeil, maux récurrents, anxiété qui s’installe. Mais le plus dérangeant, c’est ce message sous-jacent : le dialogue cède devant la contrainte physique. Les châtiments corporels n’apprennent pas à s’autoréguler, ils placent simplement la force au sommet de la hiérarchie familiale, ouvrant la porte à des cercles difficiles à briser.
Pourquoi la violence éducative résiste malgré ses conséquences ?
La violence éducative subsiste en France, envers et contre toutes les alertes. D’après la Fondation pour l’Enfance, une large majorité de parents continue à défendre la gifle ou la fessée comme méthode d’autorité. Ce réflexe s’explique en grande partie par des transmissions intergénérationnelles enfouies : ce qu’on a vécu, on le reproduit, souvent sans y réfléchir.
La croyance selon laquelle la violence éducative ordinaire garantirait l’autorité reste tenace. Bon nombre de parents y voient encore la condition pour se faire respecter. Si la loi de 2019 pose un cadre légal clair, il se heurte à des habitudes profondément ancrées. Les textes sont limpides sur le papier, les pratiques évoluent au compte-gouttes.
À cette inertie s’ajoute une pression diffuse : peur de ne pas être à la hauteur, d’être jugé, d’échouer à poser les limites. Le manque de ressources, la solitude face au doute, renforcent la tentation de faire “comme avant”. Les alternatives à la violence existent, mais peinent à se faire entendre face au poids de l’héritage familial et aux injonctions sociales. Accepter d’autres approches implique d’interroger toute une vision de l’enfance et de la parentalité, un pas rarement simple à franchir.
Des alternatives concrètes pour une éducation positive et respectueuse
Pourtant, un autre modèle existe et prouve chaque jour son efficacité. La discipline positive propose des méthodes concrètes pour instaurer autorité et sécurité, sans passer par la violence éducative ordinaire. La recette ? De l’écoute, du dialogue et la volonté de bâtir un respect réciproque. L’enfant ne cherche pas à défier gratuitement, il teste, il expérimente, il se construit.
Voici une sélection de principes qui peuvent véritablement faire la différence dans le quotidien familial :
- Proposer des choix adaptés à l’âge : “Tu préfères te brosser les dents avant ou après l’histoire ?”
- Valoriser les efforts : “J’ai remarqué que tu as pris le temps d’expliquer ce que tu ressentais.”
- Favoriser la réparation plutôt que la sanction pure : “Comment peux-tu réparer ce qui vient de se passer ?”
Énoncer clairement les règles et les expliquer rassure l’enfant. En cas d’émotion forte, la nommer (“Je vois que tu es en colère”) aide à désamorcer la crise et à installer la confiance. Inspirées de l’éducation bienveillante, ces pratiques désactivent l’escalade des conflits et invitent le dialogue.
Ce qui change tout, c’est la cohérence et la régularité. Un cadre sans humiliation permet à l’enfant d’intégrer réellement la notion de limite. Les outils comme le renforcement positif ou le recours à un temps calme ouvrent la voie à un respect mutuel, tout en tenant compte du développement affectif et social de chacun.
Ressources et accompagnement pour aller plus loin dans la parentalité bienveillante
S’engager vers des pratiques non violentes peut nécessiter un vrai accompagnement. De nombreuses ressources, collectifs ou professionnels, viennent épauler les familles désireuses de s’affranchir des violences éducatives ordinaires. Sur le terrain, des associations travaillent main dans la main avec les parents, relayant conseils, outils pratiques et espaces d’écoute. À l’échelle internationale, des organismes comme l’UNICEF ou la Fondation pour l’Enfance publient des guides clairs, organisent des rencontres et diffusent des campagnes en faveur de la protection de l’enfance et de la parentalité bienveillante.
Les ouvrages de Catherine Gueguen ou de Catherine Dumonteil Kremer constituent de précieuses ressources : s’appuyant sur les neurosciences et la psychologie de l’enfant, ils offrent à chacun des clés pratiques pour comprendre l’impact des violences ordinaires et construire de nouveaux repères durables.
Voici quelques formes de soutien qui existent pour accompagner les parents dans ce cheminement :
- Rencontres et groupes de parole animés par des spécialistes de la parentalité
- Lignes d’écoute et services d’accompagnement téléphonique
- Ateliers concrets pour apprendre à gérer les situations conflictuelles à la maison
De nombreuses structures proposent aussi des supports numériques, des brochures pédagogiques ou des programmes d’accompagnement adaptés à chaque besoin. Le partage entre parents, l’écoute et le conseil de professionnels, jouent un rôle décisif pour sortir du schéma de la violence et instaurer, pas à pas, un mode d’éducation apaisé et respectueux.
Rompre avec l’automatisme du geste ne se fait jamais d’un claquement de doigts. Chaque choix différent dessine pourtant une trajectoire nouvelle, où l’enfant grandit sans crainte. Peut-être est-ce ainsi que s’ouvre la possibilité d’une autre histoire, écrite main dans la main, parent et enfant réunis.