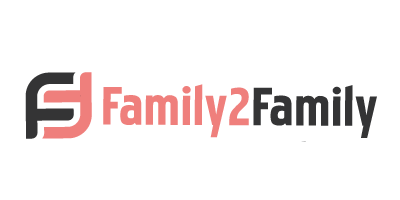À 20 mois, certains enfants ne marchent pas encore, alors que d’autres du même âge courent déjà partout. Les disparités dans l’acquisition de la marche intriguent et inquiètent, malgré l’absence de règles strictes sur le calendrier du développement moteur.
Des facteurs médicaux, émotionnels ou environnementaux peuvent retarder ce cap sans pour autant signaler un trouble grave. Comprendre ces causes et adopter les bonnes stratégies permet d’accompagner l’enfant dans ses progrès, tout en préservant un climat familial serein.
Comprendre le rythme de développement moteur à 20 mois
Pas de chronomètre universel pour l’acquisition de la marche : chaque enfant trace son chemin, à son allure. À 20 mois, certains s’élancent déjà, d’autres préfèrent encore ramper, grimper ou se hisser debout en s’appuyant sur une chaise. La marche ne surgit jamais seule : elle s’inscrit dans un vaste ensemble, celui du développement moteur. Système nerveux, squelette, muscles, réseaux de neurones… tout concourt à l’émergence de ce nouveau geste, et rien ne s’improvise.
Ce sont la maturation des structures, le tonus, la coordination et l’équilibre qui ouvrent la voie à la marche. Les professionnels de santé, notamment le pédiatre, surveillent l’évolution globale grâce aux courbes de croissance et aux repères consignés dans le carnet de santé. Si la plupart des enfants marchent spontanément entre 12 et 18 mois, ce n’est qu’après 18-20 mois que l’on commence à parler de retard selon les critères médicaux.
À cet âge, les progrès ne s’arrêtent pas là. Le langage s’envole, l’enfant affirme ses goûts, découvre parfois la néophobie alimentaire. Les activités manuelles, la manipulation, l’exploration corporelle stimulent la maturité motrice : toucher, saisir, construire, tout participe à la structuration du schéma corporel. Favoriser la motricité libre, c’est offrir à l’enfant l’espace et le temps de découvrir ses propres capacités sans contrainte. Ce choix encourage la confiance, l’envie d’expérimenter, et souvent une marche plus solide.
Pourquoi certains enfants marchent plus tard : facteurs à connaître
La diversité des parcours se manifeste très tôt. À 20 mois, il arrive qu’un enfant prenne son temps pour marcher. Le tempérament pèse : un petit passionné par le langage ou la dextérité fine préfère parfois approfondir ces domaines avant de s’aventurer debout. Le poids, la taille, l’aisance corporelle influencent aussi l’équilibre, mais aucun de ces éléments n’empêche systématiquement la marche.
L’environnement, lui, a un impact non négligeable. Un cadre rassurant, un espace propice à la motricité libre, la présence de surfaces variées : tout cela invite l’enfant à essayer, à recommencer. L’hérédité entre en jeu : si d’autres membres de la famille ont marché tard, il n’y a souvent pas lieu de s’alarmer.
Voici les principaux éléments à surveiller ou à connaître lorsqu’un enfant ne marche pas encore à 20 mois :
- Facteurs mécaniques : des atteintes osseuses, articulaires ou musculaires (par exemple, jambes arquées, problèmes de hanche ou certaines maladies musculaires) peuvent expliquer un retard pour marcher.
- Causes neurologiques : une atteinte du cerveau ou un trouble moteur plus global peuvent être à l’origine d’un décalage notable.
- Retard global : lorsque le retard concerne plusieurs aspects du développement, le pédiatre peut rechercher un trouble neuro-développemental.
Une surveillance attentive reste de mise en cas de doute. Le pédiatre, le médecin généraliste ou le professionnel de PMI évalue la situation dans sa globalité et peut proposer un accompagnement par un kinésithérapeute ou un psychomotricien. Impossible de ne pas penser à Einstein, dont le parcours illustre bien que marcher tard n’a jamais empêché d’aller loin.
Comment accompagner son enfant dans l’apprentissage de la marche sans pression
La motricité libre s’impose comme une boussole : laisser l’enfant explorer, manipuler, se relever à sa façon, sans vouloir accélérer le processus. Ce principe, défendu par des psychomotriciens comme Emmanuelle, fait de l’autonomie le cœur de l’apprentissage. L’environnement doit inviter à l’essai : surfaces variées, chaussures souples ou pieds nus pour favoriser l’équilibre, et espace sécurisé pour que l’enfant puisse évoluer sans danger.
L’encouragement compte : un sourire, un mot, un geste. Inutile de pousser ou de forcer, le soutien discret porte souvent plus loin que toutes les injonctions. Attention au « youpala » : ce trotteur fausse la perception du corps dans l’espace et retarde l’acquisition des bons réflexes moteurs. Si besoin, privilégiez un chariot de marche stable, bien adapté à la taille de l’enfant, qui accompagne sans entraver.
Voici quelques pistes pour soutenir l’enfant tout au long de cette étape :
- Respecter son rythme : marcher à 13 mois ou à 20 mois, cela ne préjuge pas de la suite du développement.
- Multiplier les jeux moteurs : tunnels, coussins, objets à pousser ou à tirer stimulent l’envie de bouger et développent la conscience du corps.
Observer, c’est aussi savoir apprécier chaque progrès : un enfant qui se redresse, qui lâche un support, qui affine ses gestes, construit peu à peu sa marche. La confiance, l’absence de compétition ou de comparaison avec d’autres enfants, sont les meilleurs alliés pour traverser cette période avec sérénité.
Gérer les frustrations et les colères : conseils pratiques pour des parents sereins
À 20 mois, l’enfant découvre ses propres limites, affirme ses désirs. Les accès de frustration fusent : refus de s’habiller, colère au repas, larmes au coucher. Ces tempêtes, parfois déroutantes, témoignent de la construction de la personnalité et de l’envie d’autonomie. L’angoisse de séparation peut ressurgir, perturbant le sommeil ou la confiance. Parents et proches s’interrogent, parfois épuisés, sur la meilleure façon d’accompagner ces bouleversements émotionnels.
La néophobie alimentaire fait aussi son apparition : l’enfant boude certains aliments, réclame toujours les mêmes plats. Les pédiatres insistent : il ne s’agit ni d’un caprice, ni d’un signe d’inquiétude. Variez sans insister, proposez de nouvelles saveurs, respectez l’appétit. La stabilité du cadre rassure l’enfant et lui laisse le temps d’apprivoiser la nouveauté.
Quelques repères concrets permettent d’apaiser les conflits et de soutenir l’enfant dans ses émotions :
- Formuler des limites claires, sans s’emporter.
- Reconnaître l’émotion : « Tu es en colère, tu voulais continuer à jouer ».
- Offrir une alternative : un livre, un objet familier, une activité pour détourner l’attention.
Les difficultés d’endormissement peuvent s’accentuer lors du passage au lit de grand. Un rituel, une veilleuse, la présence d’un doudou confortent l’enfant et facilitent le coucher. Prudence accrue en cas de maladie : une gastro-entérite impose de veiller à l’hydratation ; une conjonctivite réclame un traitement adapté ; la grippe motive une consultation médicale. Les visites chez le médecin ou le pédiatre sont remboursées par la sécurité sociale, la complémentaire santé prend le relais selon les garanties. Au final, chaque étape franchie, chaque résistance surmontée, tissent la toile de l’autonomie à venir. Qui sait ce que ces petits pieds, une fois lancés, choisiront de parcourir demain ?